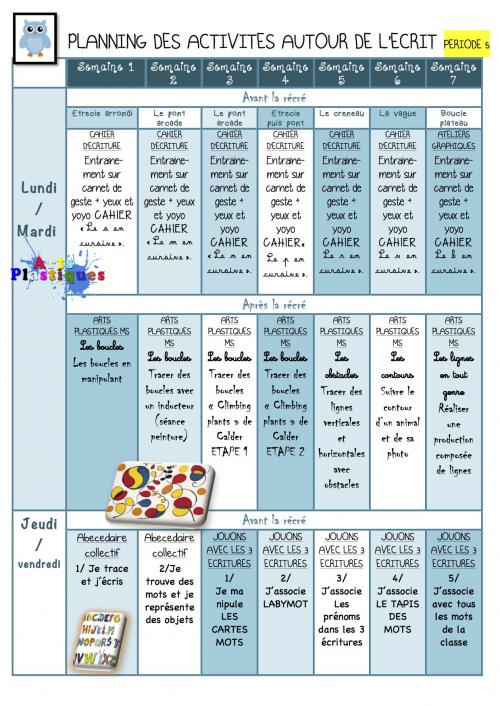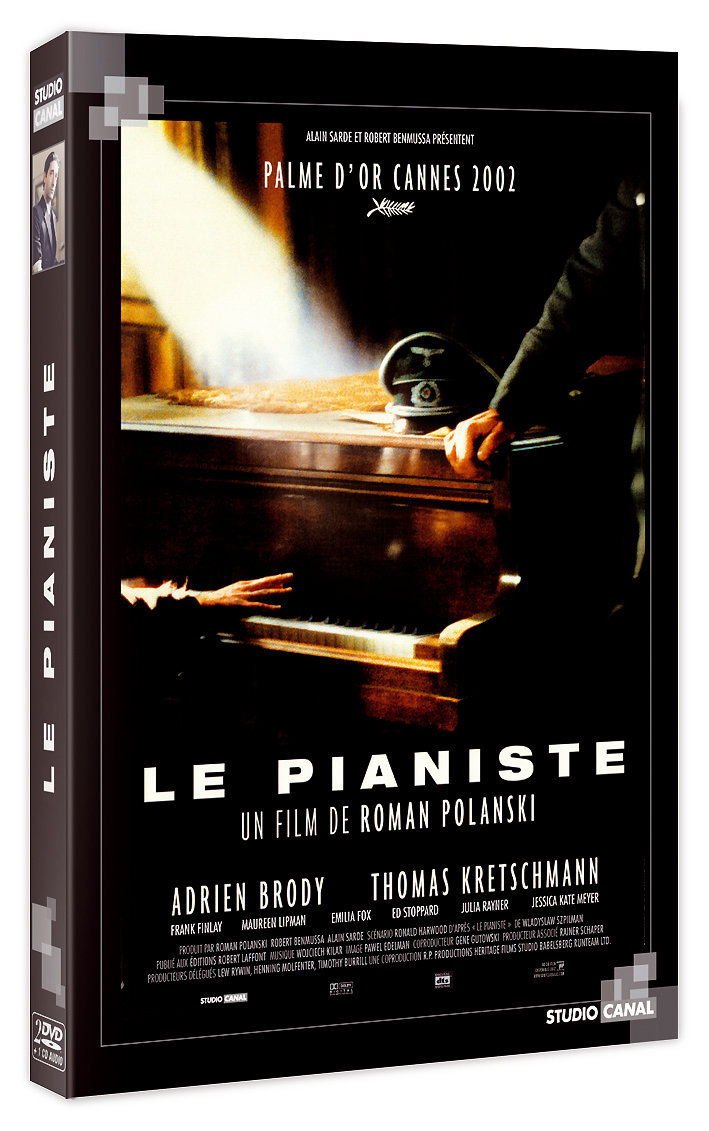Dans l’histoire européenne de l’accès des femmes aux professions, le passage du 19e au 20e siècle occupe une place particulière. Certes, il y a eu, à toutes les époques, quelques femmes exerçant des activités traditionnellement réservées aux élites masculines. De même, les femmes des classes populaires ont toujours travaillé en ville comme à la campagne.
Dans l’histoire européenne de l’accès des femmes aux professions, le passage du 19e au 20e siècle occupe une place particulière. Certes, il y a eu, à toutes les époques, quelques femmes exerçant des activités traditionnellement réservées aux élites masculines. De même, les femmes des classes populaires ont toujours travaillé en ville comme à la campagne.
Mais la fin du 19e siècle voit se constituer une revendication collective, organisée et inédite en faveur de l’accès des filles aux titres universitaires ainsi qu’aux professions traditionnellement exercées par les hommes de la bourgeoisie. Dans les débats politiques et la production culturelle de l’époque, un nouveau personnage apparaît : la « diplômée ». Elle se confond alors avec la figure, redoutée par les uns, espérée par les autres, de « l’Ève future », de la « femme nouvelle », de la « féministe » ou de « l’émancipée », qui bouleverse la division ordinaire des rôles de genre dans la famille bourgeoise.
-
Rennes J., 2019, « Femmes en métiers d’hommes. Récits de la modernité et usages marchands du féminisme dans le Paris de 1900 », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n°66/2, 63-95.
-
Rennes J., 2013, Femmes en métiers d’hommes (1890-1930). Une histoire visuelle du travail et du genre. Saint-Pourçain : Bleu autour.
Les féministes et l’accès aux études supérieures
 Des débuts de l’époque moderne jusqu’au 18e siècle, les rares femmes qui exercent des activités traditionnellement réservées aux élites masculines, dans les arts, les sciences, les lettres ou le droit, sont recensées comme de brillantes exceptions à travers des catalogues de « femmes illustres ». En France, au 17e siècle, quelques penseuses et penseurs, comme Marie de Gournay (1565-1645), Gabrielle Suchon (1632-1703) ou François Poulain de la Barre (1647-1723), érigent ces femmes en preuve de l’égale capacité des deux sexes. Mais ces démonstrations ne se traduisent guère par des mouvements collectifs et organisés pour rendre accessibles aux femmes les formations, activités, titres et fonctions réservés aux hommes.
Des débuts de l’époque moderne jusqu’au 18e siècle, les rares femmes qui exercent des activités traditionnellement réservées aux élites masculines, dans les arts, les sciences, les lettres ou le droit, sont recensées comme de brillantes exceptions à travers des catalogues de « femmes illustres ». En France, au 17e siècle, quelques penseuses et penseurs, comme Marie de Gournay (1565-1645), Gabrielle Suchon (1632-1703) ou François Poulain de la Barre (1647-1723), érigent ces femmes en preuve de l’égale capacité des deux sexes. Mais ces démonstrations ne se traduisent guère par des mouvements collectifs et organisés pour rendre accessibles aux femmes les formations, activités, titres et fonctions réservés aux hommes.
C’est au cours du 19e siècle européen que de telles revendications se développent : portées par des associations, des revues féministes émergentes et leurs alliés politiques, favorisées par la scolarisation primaire croissante des filles et la diffusion de l’idéologie méritocratique, les réclamations d’accès des jeunes filles aux études secondaires et supérieures rencontrent l’assentiment d’une partie des parents de la bourgeoisie industrielle et/ou intellectuelle. En effet, certaines de ces familles, dépourvues des ressources économiques leur permettant de doter leurs filles en vue d’un « beau mariage », perçoivent le diplôme comme une solution permettant à ces dernières d’accéder à des professions qui leur évitent le « déclassement ».
De l’Italie à la Russie, en passant par l’Angleterre, la Belgique, la Suisse, les pays scandinaves ou l’Empire austro-hongrois, on autorise progressivement les femmes à s’inscrire à l’Université entre les années 1860 et les années 1900, selon des rythmes et des modalités variées. En 1901, les femmes représentent 15 % des étudiants en Angleterre où des collèges spécifiquement féminins ont commencé à se développer à partir des années 1870. A la même date, en France, les femmes, qui investissent des universités historiquement masculines, ne constituent que 3 % des effectifs. Cette timide féminisation suscite de vives résistances où se mêlent antiféminisme, protectionnisme professionnel et xénophobie : parmi les premières étudiantes en droit, en sciences, en art et en médecine figure une forte proportion d’immigrées.
-
Tikhonov Sigrist N., 2009, « Les femmes et l’université en France, 1860-1914 », Histoire de l’Éducation, n°122. http://journals.openedition.org/histoire-education/1940
Les étudiantes étrangères à Paris
 Si les populations étudiantes féminines proviennent en majorité de familles bourgeoises, elles ne sont pas nécessairement issues des bourgeoisies des pays où elles font leurs études. Ainsi, à Paris, les étrangères sont plus nombreuses que les Françaises dans la plupart des facultés jusqu’aux années 1890. Parmi elles, dominent Russes et Polonaises : exilées en Allemagne, en Suisse, en France et en Angleterre, certaines fuient les restrictions imposées par l’État russe aux Juifs des deux sexes et aux femmes de toutes confessions dans l’accès à l’enseignement supérieur, d’autres la politique de russification forcée de la Pologne.
Si les populations étudiantes féminines proviennent en majorité de familles bourgeoises, elles ne sont pas nécessairement issues des bourgeoisies des pays où elles font leurs études. Ainsi, à Paris, les étrangères sont plus nombreuses que les Françaises dans la plupart des facultés jusqu’aux années 1890. Parmi elles, dominent Russes et Polonaises : exilées en Allemagne, en Suisse, en France et en Angleterre, certaines fuient les restrictions imposées par l’État russe aux Juifs des deux sexes et aux femmes de toutes confessions dans l’accès à l’enseignement supérieur, d’autres la politique de russification forcée de la Pologne.
À Paris, de 1893 à 1906, Russes et Polonaises représentent plus de 70 % des étudiantes étrangères : Certaines étudient les sciences, comme Maria Sklodowska (qui devient Curie par mariage en 1895) née en Pologne en 1867, arrivée à la Faculté des Sciences de Paris en 1891, docteure es sciences physiques et prix Nobel en 1903. Mais elles sont aussi bien représentées en art, en médecine et en droit. En 1900, à Paris, l’atelier de sculpture d’Auguste Rodin accueille cent femmes sur deux cents élèves, dont une grande partie est originaire de l’Empire russe, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Les étrangères fréquentent aussi l’atelier Humbert de l’École des Beaux-arts, gratuit et réservé́ aux étudiantes ou encore l’Académie Julian, qui a ouvert un atelier de peinture aux femmes en 1873. La Russe Marie Bashkirtseff (1858-1884), demeurée célèbre, malgré son décès à 25 ans, grâce à son Journal et quelques tableaux conservés fut l’une de ses élèves.
Quant à la première femme à prêter serment d’avocat à Paris, en 1900, sous le nom de Madame Petit, c’est une Ukrainienne issue d’une famille d’industriels et d’ingénieurs, Scheïna Léa Balachowksy. Comme Mesdames Petit et Curie, les étrangères qui demeurent en France voient leur origine en partie rendue invisible par leur mariage avec des Français.
Cela n’empêche pas l’antiféminisme de l’époque de se teinter de xénophobie (et parfois d’antisémitisme) envers l’étudiante « russe », qualificatif qui ne distingue pas les Russes des Polonaises. Cette figure est alors représentée comme un prototype de « femme savante » sacrifiant sa « féminité » à son ambition intellectuelle. Davantage encore que l’étudiante simplement inscrite à l’Université, c’est la diplômée, celle qui prétend accéder par ses titres universitaires à des professions traditionnelles de la bourgeoisie masculine, qui cristallise l’hostilité.
-
Moulinier P., 2014, « Les étudiants étrangers à Paris en 1900 », Hommes & Migrations [En ligne], n°1308, décembre. http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/paris-fait-par-ses-immigres/7565-les-etudiants-etrangers-a-paris-en-1900
-
Bashkirtseff M., 2000, Journal de Marie Bashkirtseff (extraits), Paris : Mercure de France.
-
Reynolds S., 1998, « Comment peut-on être femme sculpteur en 1900 ? Autour de quelques élèves de Rodin », Mil Neuf Cent, n°16, 9-25.
L’accès aux professions médicales
 Au moment où l’Anglaise Elizabeth Garrett, première titulaire d’un doctorat de médecine en France en 1870, repart en Angleterre et contribue à créer, en 1874, la première école de médecine féminine à Londres, on débat en France de l’accès des femmes à l’externat puis à l’internat qui permet de devenir médecin des hôpitaux. Après plus de dix ans de controverses qui clivent le monde médical, politique et journalistique, les étudiantes obtiennent l’accès à ces deux grades en 1881 et 1885. La Hollande, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la Norvège, la Belgique, la Grèce et l’Empire austro-hongrois admettent également les femmes médecins entre les années 1870 et 1900.
Au moment où l’Anglaise Elizabeth Garrett, première titulaire d’un doctorat de médecine en France en 1870, repart en Angleterre et contribue à créer, en 1874, la première école de médecine féminine à Londres, on débat en France de l’accès des femmes à l’externat puis à l’internat qui permet de devenir médecin des hôpitaux. Après plus de dix ans de controverses qui clivent le monde médical, politique et journalistique, les étudiantes obtiennent l’accès à ces deux grades en 1881 et 1885. La Hollande, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la Norvège, la Belgique, la Grèce et l’Empire austro-hongrois admettent également les femmes médecins entre les années 1870 et 1900.
Cependant l’hostilité à leur égard perdure au sein des professions médicales qui peinent à se féminiser. La Suisse — qui, en 1866, avait été le premier pays européen à délivrer un doctorat de médecine à une étudiante, la Russe Nadejda Souslova, à l’Université de Zurich — ne compte en 1900 que 26 femmes exerçant la médecine. En France, entre 1914 et 1930, le taux de féminisation de la profession se maintient à 2 % ; en Grande-Bretagne, les 477 femmes médecins enregistrées en 1911 ne représentent également que 2 % des effectifs. Les résistances à la féminisation rencontrées partout au sein du monde médical poussent les femmes médecins à organiser des réseaux d’entraide et de solidarité, telle l’Association internationale des femmes médecins créée en 1919.
L’accès à la profession d’avocat
Succédant aux débats sur la doctoresse, ceux sur l’avocate agitent les barreaux suisse, italien, belge et français à partir de la fin du 19e siècle : les arguments en faveur de l’ouverture aux femmes du métier d’avocat circulent entre ces différents pays. En effet, certains juristes féministes se mobilisant dans plusieurs pays à la fois, tel l’avocat belge Louis Frank qui milite pour l’accès des femmes au barreau belge, français et italien.
 Pour sa part, Émilie Kempin-Spyri, première docteure en droit d’une université européenne en 1887 (à Zurich, tout comme la première docteure en médecine), se bat pour faire ouvrir le barreau aux femmes sans obtenir gain de cause de son vivant (elle meurt en 1901). La Française Jeanne Chauvin, titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de Paris en 1892, sera plus chanceuse. Après s’être vue refuser en 1897 l’accès au barreau de Paris, accessible à ses condisciples masculins avec une simple licence, elle mobilise des parlementaires, des juristes, des journalistes et des associations féministes. Divisant le monde politique pendant plusieurs années, la cause de « la femme avocat » débouche sur la loi du 1er décembre 1900 ouvrant le barreau aux femmes.
Pour sa part, Émilie Kempin-Spyri, première docteure en droit d’une université européenne en 1887 (à Zurich, tout comme la première docteure en médecine), se bat pour faire ouvrir le barreau aux femmes sans obtenir gain de cause de son vivant (elle meurt en 1901). La Française Jeanne Chauvin, titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de Paris en 1892, sera plus chanceuse. Après s’être vue refuser en 1897 l’accès au barreau de Paris, accessible à ses condisciples masculins avec une simple licence, elle mobilise des parlementaires, des juristes, des journalistes et des associations féministes. Divisant le monde politique pendant plusieurs années, la cause de « la femme avocat » débouche sur la loi du 1er décembre 1900 ouvrant le barreau aux femmes.
De la Première Guerre mondiale aux années 1930, plusieurs États, de l’Angleterre à la Russie soviétique, en passant par l’Allemagne, la Belgique l’Italie, l’Espagne et l’Empire austro-hongrois autorisent également l’admission des femmes au barreau. Mais dans certains pays, des avocates commencent à plaider avant l’accès officiel des femmes au barreau : dans un contexte d’indépendance relative des tribunaux et des législatures coloniales, Cornelia Sorabji, Indienne licenciée en droit de l’Université d’Oxford en 1892, obtient par exemple l’autorisation de plaider devant un tribunal britannique à Poona en 1896. Elle devient ainsi la première avocate dans un tribunal de l’Empire britannique, alors que les femmes n’y furent officiellement autorisées à être avocates qu’en 1919.
L’ouverture du barreau aux femmes n’entraîne nullement la féminisation des autres professions judiciaires : seuls quelques pays, comme l’Allemagne, la Tchécoslovaquie, le Danemark ou la Russie soviétique ouvrent la magistrature aux femmes avant la Seconde guerre mondiale. Tout comme en médecine, les obstacles rencontrés contribuent au développement d’associations féminines professionnelles, telle la Fédération Internationale des Femmes de Carrière Juridique en 1929.
-
Mossman M. J., 2006, The First Women Lawyers: A Comparative Study of Gender, Law and the Legal Professions, Oxford, Portland (Oregon) : Hart Publishing.
De la diplômée à la « femme nouvelle »
 Le fait que les premières avocates et juristes étaient souvent des militantes du droit des femmes, utilisant leur compétence professionnelle pour réclamer l’égalité des sexes, renforçait l’hostilité qu’elles suscitaient. Cet engagement féministe était moins systématiquement présent dans les trajectoires des femmes médecins, scientifiques ou artistes d’alors. Cependant, les arguments politiques mobilisés contre l’ensemble de ces pionnières et la satire visuelle qui circulait d’un pays à l’autre, à travers spectacles, dessins de presse, cartes postales et premières fictions filmées, mettaient très largement en équivalence toutes les « diplômées » : elles étaient vues comme manifestant et accélérant l’avancée des idées féministes, lesquelles rendraient méconnaissable le partage des territoires professionnels masculins et féminins.
Le fait que les premières avocates et juristes étaient souvent des militantes du droit des femmes, utilisant leur compétence professionnelle pour réclamer l’égalité des sexes, renforçait l’hostilité qu’elles suscitaient. Cet engagement féministe était moins systématiquement présent dans les trajectoires des femmes médecins, scientifiques ou artistes d’alors. Cependant, les arguments politiques mobilisés contre l’ensemble de ces pionnières et la satire visuelle qui circulait d’un pays à l’autre, à travers spectacles, dessins de presse, cartes postales et premières fictions filmées, mettaient très largement en équivalence toutes les « diplômées » : elles étaient vues comme manifestant et accélérant l’avancée des idées féministes, lesquelles rendraient méconnaissable le partage des territoires professionnels masculins et féminins.
En réalité, ce monde à venir n’était pas pour demain : des secteurs professionnels entiers étaient encore réservés aux hommes dans la haute administration, la politique, la police, l’armée, la justice, l’université, le transport, le bâtiment et l’industrie. Cependant, ces « femmes nouvelles » n’en avaient pas moins troublé l’évidence de l’assignation des femmes bourgeoises au foyer domestique. Par-delà les débats sur les capacités intellectuelles et professionnelles féminines, elles soulevaient des interrogations inédites sur les rôles de genre dans la sphère privée : la représentation du foyer délaissé de la doctoresse, de la femme savante ou de l’avocate est une scène courante du théâtre européen de l’époque et un stéréotype dans la culture visuelle satirique.
Nombre de féministes de l’époque rétorquaient que les femmes diplômées n’en seraient pas moins de bonnes épouses et mères : bien des travailleuses des classes populaires exerçant des métiers hors du foyer avaient montré de longue date, faisaient-elles valoir, que les femmes pouvaient concilier un travail à l’extérieur et le rôle domestique qui leur est traditionnellement dévolu. Il faut attendre les années 1970 pour que le partage des activités parentales et domestiques soit constitué comme une question féministe et que l’on proclame que la sphère privée, elle aussi, est un enjeu politique.
- Mondes Sociaux a aussi publié :
- Dejardin C., Femmes entrepreneures du XIXe siècle, septembre 2019

Crédits images en CC : Svg Silh, Publicdomainvectors.org, Patrick Mignard pour Mondes Sociaux, collection personnelle Juliette Rennes, Wikimedia Commons, Pearson Scott Foresman